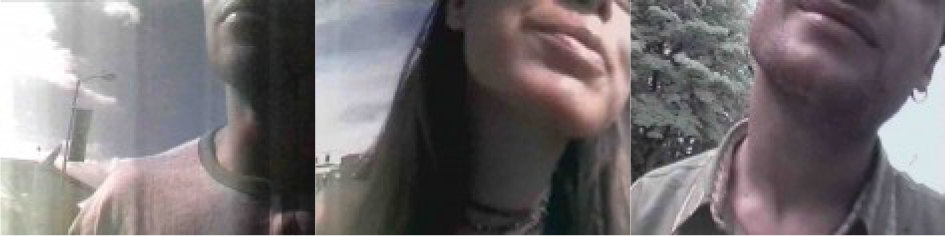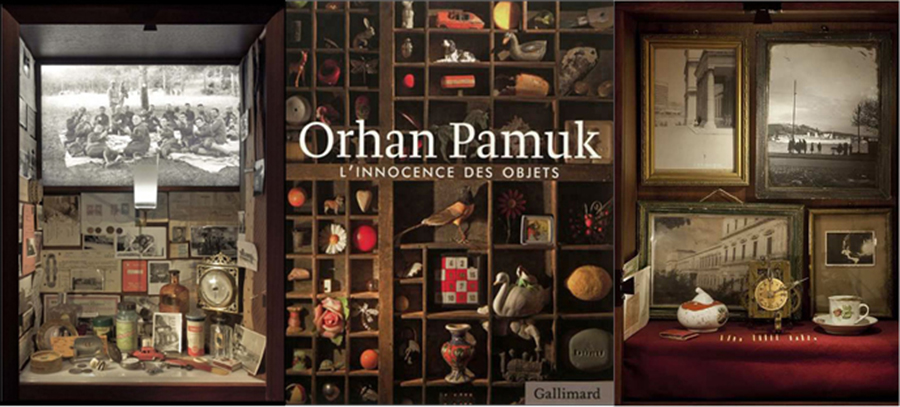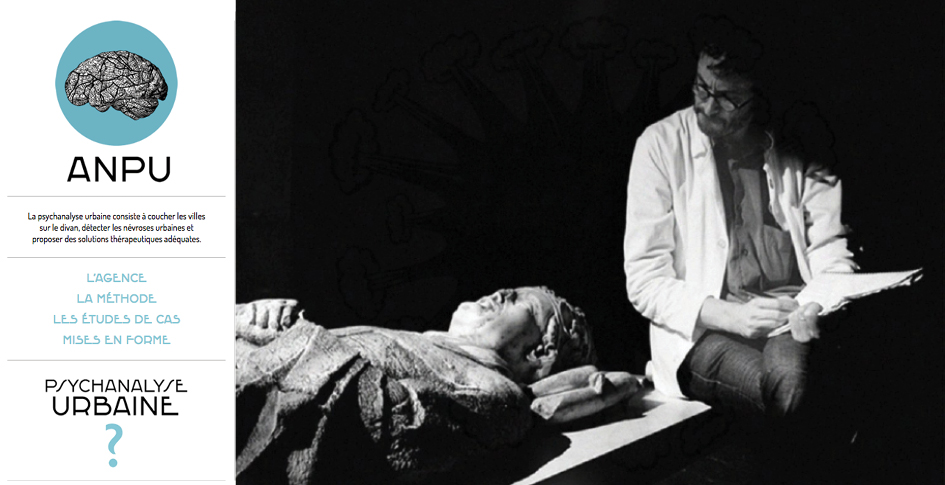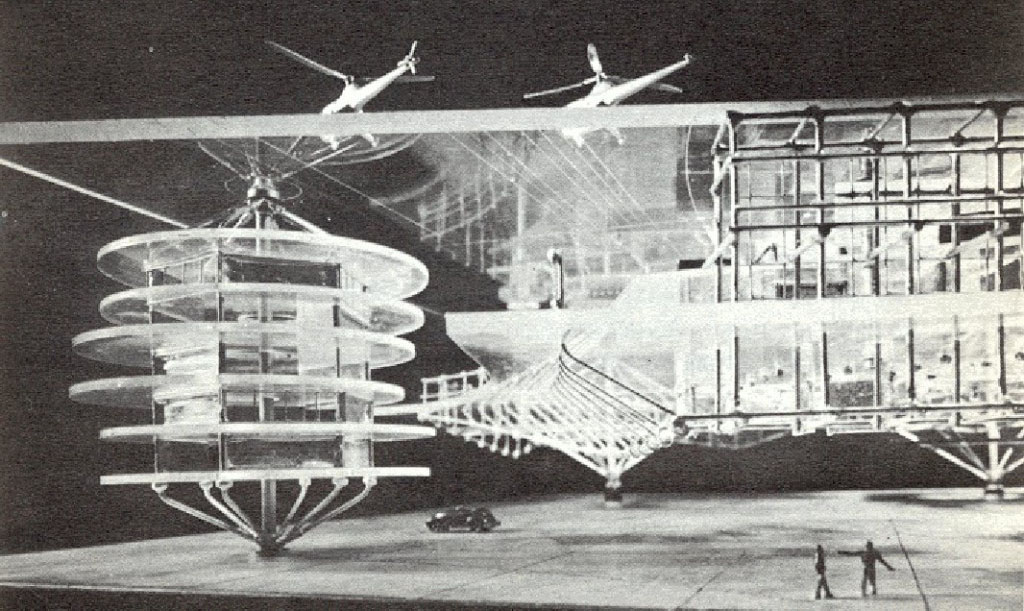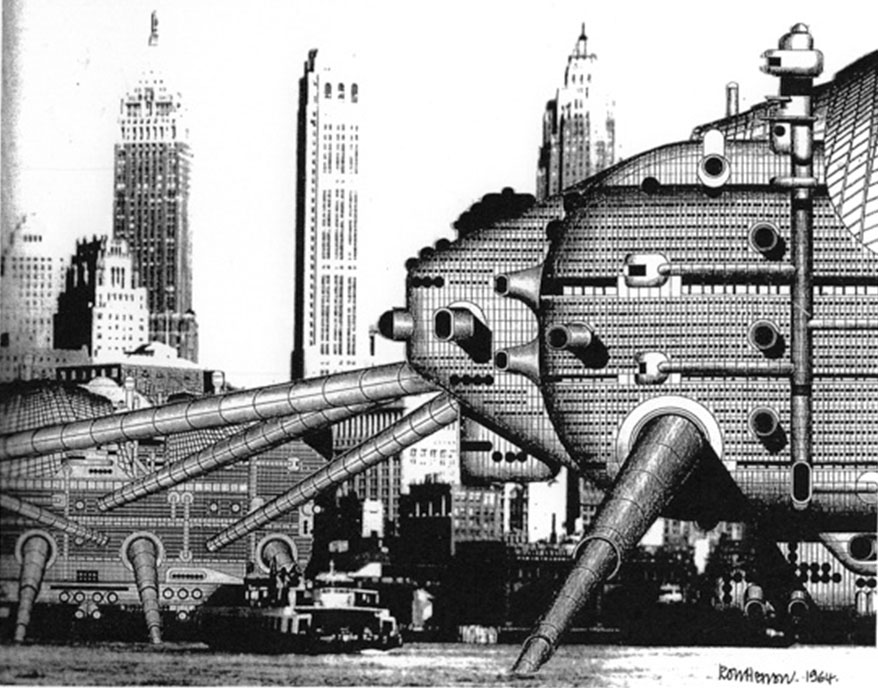Il y a plus dans ce propos que la simple intention de choquer en se moquant du romantisme traditionnellement attaché à la nature. La démarche révolutionnaire de Guy Debord, nous le verrons plus loin, est d’une extrême cohérence, elle s’attache à la reconquête par chaque individu de son environnement pour permettre une prise de conscience préalable à tout autre engagement. Or, comme nous l’avons appris, l’art « sérendipien » de la marche nécessite les découvertes inattendues que seul le hasard sait provoquer. La ville est capable d’offrir beaucoup plus d’opportunités en ce domaine que la nature.
C’est un fait reconnu, les enfants des villes grandissent désormais plus vite que les autres, car la ville regorge de surprises, d’occasions de découverte, de sujets d’étonnement. Chaque itinéraire dans la ville ressemble à un labyrinthe enchanté, et il est rare qu’ils en reviennent bredouilles. Les adultes ne voient plus rien, c’est pour cela qu’ils se plaignent toujours de la monotonie de leur vie. Mais les enfants, eux, ont l’attention perpétuellement en éveil. Retrouvons dans notre quotidien cet esprit de recherche aventureuse et nous deviendrons des artistes. Pour généreuse qu’elle soit, la nature ne peut nous offrir autant d’opportunités. Devant un paysage grandiose, on s’ébahit, on rêve, on poétise ; en revanche dans les rues de la ville, on s’étonne, on réfléchit, on se découvre… On crée !
Notre premier allié dans la ville, c’est la foule, dont Walter Benjamin prétendait qu’elle était « le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur en phantasmagorie (2) ». Ce que nous offre la masse de désirs et d’intérêts que représentent les piétons est intarissable. La ville permet des confrontations continuelles, elle est un choc permanent d’images, d’évènements minuscules, de morceaux de dialogues entendus, d’informations forçant le regard ou de rêveries sans conséquence, qui nous pénètrent, nous nourrissent sans qu’on y prenne garde. L’arpenteur des rues, ce « prince qui jouit partout de son incognito » comme l’a décrit Charles Baudelaire, est le maître sans partage de ses perceptions. Il trie ses impressions, filtre ses convoitises, se laisse aller à des songes furtifs d’aventures improbables. Le registre des opportunités offertes à l’artiste marchant est sans fin.
On peut, à la façon des surréalistes, considérer que ceux que nous croisons et bousculons ne sont que des formes capables d’endosser toutes sortes d’identités. Louis Aragon s’y entendait : ce passant « est une statue de pierre en marche, cet autre est une girafe changée en bookmaker, et celui-ci, ah celui-ci chut : c’est un amoureux (3) ». Ainsi le marcheur met en scène son quotidien au fil de son parcours, recomposant un décor plus proche de ses aspirations. Tour à tour, Gérard de Nerval, dans son poème « Une allée du Luxembourg », et Charles Baudelaire, dans son poème « A une passante », ont décrit le coup de foudre soudainement éprouvé en croisant dans la rue hostile (« La rue assourdissante autour de moi hurlait ») une silhouette à peine entrevue mais cristallisant tous les désirs (« La douceur qui fascine et le plaisir qui tue »). La beauté peut être parfaite et la passion fatale, quand on se contente de les imaginer, avant de poursuivre sa marche aventureuse. La rue permet tout cela : des rencontres sans risque sur lesquelles le rêve se fige, des espoirs fous et inutiles, des pensées sauvages et secrètes. Parfois, les pochoirs des artistes du street art, par la symbolique qu’ils portent, par l’endroit où ils ont été apposés, provoquent de la même façon la gêne et l’émoi habituellement liés à une intimité soudain exposée.
Des artistes jouent plus directement avec la foule de la ville et en font un acteur même de leur création. Le mode le plus discret peut être illustré par Jiri Kovanda, l’artiste tchèque que nous avons déjà croisé au chapitre précédent et qui, dans les années 1970, intervenait dans les rues pour y introduire des changements minuscules, quasiment pas repérables, car tellement proches de la vie réelle : par exemple, marcher dans la rue en frôlant des passants ou dans un escalier mécanique, se retourner soudain et regarder dans les yeux la personne qui est derrière lui. Ces interventions dérisoires, qui ne prennent sens qu’en fonction de la réaction des passants, transforment l’espace public en une sorte d’univers mental dématérialisé, où chacun peut loger ses pensées.