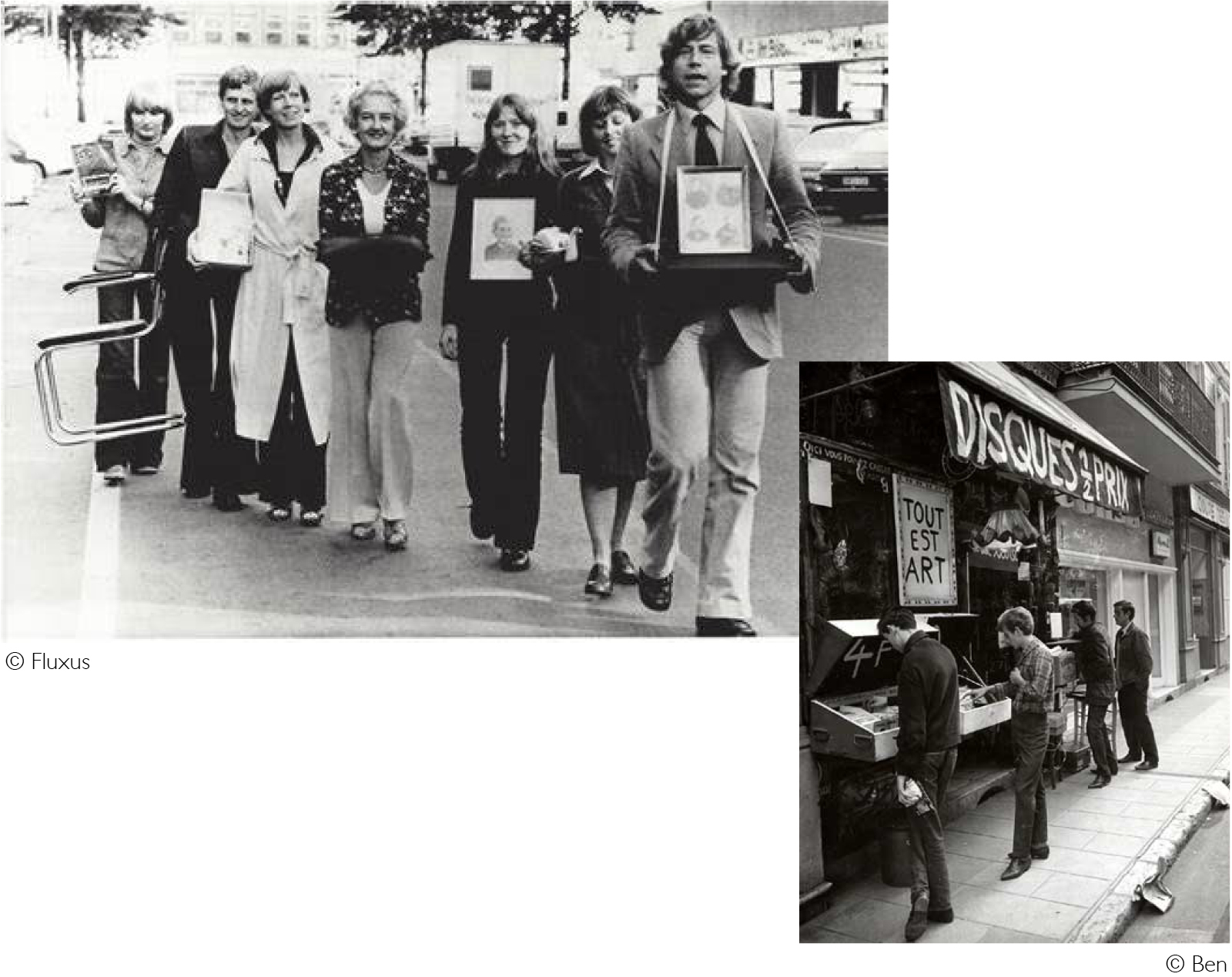L’art du peu se révèle non seulement dans ses intentions, mais également dans ses résultats. Quand l’art s’interroge sur sa finalité, Robert Filliou en appelle pour sa part à la « révolte des médiocres (18) ». Economiste de formation, il recommande une « économie poétique », où le travail ne serait plus une accumulation de tâches pénibles et subies, mais une pratique ludique ; l’art reste une affaire de spécialistes, alors qu’il devrait se concevoir comme « une fantaisie joyeuse et non spécialisée ». Sa définition est célèbre : « L’art n’est qu’un moyen pour rendre la vie plus intéressante que l’art. » Il faut donc commencer par se débarrasser du savoir-faire, susceptible de brider la créativité, et à cette fin il établit un principe d’équivalence entre le bien fait, le mal fait et… le pas fait. Ses œuvres sont en ligne avec ses principes. Au début des années 1960, il a organisé des expositions nomades dans la Galerie Légitime : en fait, il montrait aux passants des petits objets qui étaient rangés dans une casquette (qu’il avait achetée au Japon quand il travaillait pour l’ONU) ou dans un chapeau ; il appelait cela « l’art en fraude ». En 1962, le 3 juillet, entre 4 heures et 21 heures, il a erré dans les rues de Paris, en compagnie de Ben Patterson, des Halles à la Coupole, avec, de 9 heures à 11 heures, un arrêt au cimetière du Père-Lachaise, près de la tombe de Gertrude Stein. De cette dérive parisienne, il a dit qu’elle était de l’art, peut-être juste parce que son rapport au monde s’en est trouvé enrichi.
Quand on considère les médiocres résultats des œuvres entreprises sous ces auspices théoriques, la vraie question est celle que pose Jean-Yves Jouannais : « A quoi bon produire soi-même le médiocre puisque nous en sommes tous capables (19) ? » Il apporte pourtant de multiples illustrations de ces tentatives dérisoires. Par exemple, il décrit l’œuvre de Jacques Lizene, artiste belge né en 1946 et qui a pris parti dès 1966 pour un « art sans talent ». Ses productions : Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre de la photo, obligeant à des contorsions de plus en plus grotesques à mesure que l’appareil se rapproche (1971), un film raté et barré à la main image par image (1972), Sculpture nulle pour une pioche et une guitare électrique (1979). Je n’ai pas trouvé trace d’une marche en ville, mais le sujet sans doute aurait pu l’inspirer. Bien d’autres exemples seraient susceptibles d’affronter ce reproche d’un résultat médiocre ou incongru. Mais à la question qu’il a posée, Jouannais apporte une réponse convaincante : « La médiocrité n’est pas une aspiration démagogique ou masochiste à la honte, mais s’affirme comme le rêve de ménager le lien social et de pointer ce que le réel recèle de poésie véritable. » De cela, les dérives d’artistes vont nous fournir de remarquables illustrations.
En admettant maintenant que la marche soit reconnue comme une branche de l’art contemporain, il faut encore s’interroger sur la caractéristique particulière, la dimension originale, qui la rend précieuse, peut-être irremplaçable. Cette spécificité de l’art marché, je propose de la définir comme sa capacité à relier l’espace et le temps. Le marcheur se déplace aussi dans sa mémoire, il convoque ses références pour interpréter ce qu’il voit, il n’est en fait jamais sans but, même s’il a oublié lequel. Raymond Queneau aimait à dire : « A travers les rues de Paris, je reconquérais ma mémoire. » Façon de reconnaître que ce qu’il poursuivait à travers ses déambulations c’était bien « l’histoire / qui se dépose sur la ville / en traces plus ou moins futiles / qu’on déchiffre comme un grimoire (20) ». Et Italo Calvino faisait le même constat : « […] la ville ne dit pas son passé, elle le possède pareil aux lignes d’une main, inscrit au coin des rues […]. (21) » La marche dans la ville est bien une façon de réveiller les souvenirs enfouis au creux des pierres, au fond des cours, et de réenchanter la mémoire.
Remarquez d’ailleurs comme les livres de souvenirs sont emplis de lieux élevés au rang de personnages. Ils nous marquent autant que nous les marquons. Ainsi, Jacqueline Mesnil-Amar, elle est à la recherche de son mari, membre de l’Armée juive et qui n’est pas rentré chez lui le 18 juillet 1944, elle parcourt la ville en tous sens : « Tous les quartiers de Paris, je les ai traversés, au cours de cette marche interminable, tant de Paris successifs, tous mes Paris intérieurs, mes avenues, mes rues, les plus belles, les plus laides, les plus anciennes, les plus nouvelles, je les ai remontées presque les yeux fermés, étrangère à ma ville soudain, par ma peine, et pourtant liée à elle pour toujours (22). » Quelle autre œuvre que la marche serait capable d’insérer la ville dans une aventure si personnelle ? On marche dans les rues avec nos souvenirs ; ou bien ses souvenirs poussent le marcheur à fuir dans le dédale des rues ; ou encore l’artiste-marcheur abandonne des signes à l’intention de ceux qui le suivront… De toutes les manières possibles, quand on marche, les fils du temps tissent inextricablement l’espace.